26-11-1812 : Passage de la Bérézina (Russie).
Publié : Mer Nov 26, 2025 7:22 am
26 novembre 1812 : Passage de la Bérézina (Russie).
Le 26 novembre 1812, la Grande Armée de Napoléon I° arrive au bord de la Bérézina, un affluent du Dniepr au terme d'une anabase effroyable.
Dans un sursaut de la dernière chance, les débris de l'armée arrivent à franchir la rivière gelée.
Napoléon et sa garde rapprochée échappent ainsi à une capture par les poursuivants russes, qui eut signifié la fin de l'Empire.
Cet épisode a laissé dans le langage courant l'expression : «C'est la Bérézina !» pour désigner une entreprise vouée à l'échec.
Du point de vue des historiens, toutefois, le passage de la Bérézina doit être vu comme un succès de Napoléon, à défaut de victoire.
La Russie, dévoreuse de la Grande Armée
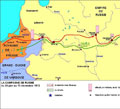
Napoléon et la campagne de Russie (Alain Houot)
Quand il franchit le Niemen avec la Grande Armée, Napoléon I° cherche comme à son habitude le choc frontal avec l'armée ennemie.
Mais, tirant parti de l'espace russe, les Russes se dérobent aux attaques et insidieusement, d'étape en étape, entraînent la Grande Armée vers l'Est...
Pitoyable retraite.
La Grande Armée était entrée en Russie le 24 juin avec près de 700.000 soldats dont 300.000 Français.
Après une campagne difficile, elle était arrivée à Moscou pour en être chassée presque aussitôt par l'incendie de la ville.
Napoléon I° avait choisi de battre en retraite par le même chemin qu'à l'aller, harcelé par les troupes ennemies... et les premiers froids de l'hiver.
Le maréchal Michel Ney commande l'arrière-garde et couvre de son mieux la pitoyable retraite.
Malgré cela, en arrivant au bord de la Bérézina, l'empereur ne dispose plus que de 49.000 combattants, non compris 40.000 retardataires.

Le 22 novembre, Napoléon apprend que les troupes qui gardaient la ville de Borissov, sur la Bérézina, ont été chassées par les Russes.
La Grande Armée ne peut plus dès lors emprunter les ponts de Borissov.
Talonnée par les 70.000 hommes de Koutouzov, elle doit néanmoins traverser la rivière au plus vite.
Survient alors l'épisode le plus dramatique de la retraite de Russie.
L'ultime défi.
Tandis que les Cosaques harcèlent les troupes démunies de tout, les pontonniers du général Eblé aménagent un passage sur la rivière gelée.
La plupart y laissent leur vie. Pendant 3 jours, ce qui reste de la Grande Armée, entrée en Russie cinq mois plus tôt, va franchir les ponts improvisés.
La glace qui recouvre habituellement la rivière en cette saison, a fondu par l'effet d'un dégel inattendu et les eaux charrient d'énormes blocs de glace.
Le général du génie Jean-Baptiste Eblé a heureusement conservé ses outils malgré les ordres de l'empereur.
En quelques heures, ses 400 pontonniers édifient deux ponts de 90 mètres de long et 5 mètres de large.

En trois jours, les troupes franchissent la rivière pendant que le général Oudinot livre bataille aux Russes afin de faire diversion.
Un pont se brise le 27 novembre, entraînant dans les flots un grand nombre de grognards.
Il est réparé dans la soirée par les pontonniers qui se jettent dans les eaux glacées.
Au matin du 29 novembre, Eblé, qui voit les Russes approcher, met le feu à ses ouvrages.
Des milliers de traînards se noient en tentant d'échapper à l'ennemi.
Parmi eux des femmes et des enfants (cantinières, prostituées, épouses cachées...).
Au sortir de la rivière, Napoléon dispose encore de 25.000 combattants et 30.000 non-combattants.
20.000 retrouveront leurs foyers...
On évalue à 50.000 le nombre de prisonniers et de déserteurs qui feront souche en Russie.
Une grande partie des pontonniers a péri de froid dans l'eau glaciale de la Bérézina.
Six seulement survivront à la retraite et Eblé lui-même mourra d'épuisement à Königsberg.

Sauve qui peut.
La débâcle est totale. L'Empereur rédige un Bulletin dramatique pour en informer l'opinion française.
Ce XXIX° Bulletin de la Grande Armée est un chef-d'œuvre de propagande.
Sans mentir, il présente les événements dans une gradation habile, passant d'une «situation fâcheuse» à une «affreuse calamité» !
Il raconte les malheurs des soldats mais aussi le grand mérite de ceux qui conservent leur gaieté dans les épreuves et se termine par cette phrase, destinée à prévenir ceux qui songeraient à renverser le régime : «La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure».
Napoléon lui-même abandonne ses soldats et rejoint en toute hâte Paris, où un obscur général républicain a tenté de renverser l'Empire.
Il arrive aux Tuileries le 18 décembre, deux jours après son Bulletin et à temps pour en gérer les effets.
Une semaine d'Histoire du 24 Novembre 2025 au 30 Novembre 2025 avec Herodote.net
Le 26 novembre 1812, la Grande Armée de Napoléon I° arrive au bord de la Bérézina, un affluent du Dniepr au terme d'une anabase effroyable.
Dans un sursaut de la dernière chance, les débris de l'armée arrivent à franchir la rivière gelée.
Napoléon et sa garde rapprochée échappent ainsi à une capture par les poursuivants russes, qui eut signifié la fin de l'Empire.
Cet épisode a laissé dans le langage courant l'expression : «C'est la Bérézina !» pour désigner une entreprise vouée à l'échec.
Du point de vue des historiens, toutefois, le passage de la Bérézina doit être vu comme un succès de Napoléon, à défaut de victoire.
La Russie, dévoreuse de la Grande Armée
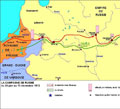
Napoléon et la campagne de Russie (Alain Houot)
Quand il franchit le Niemen avec la Grande Armée, Napoléon I° cherche comme à son habitude le choc frontal avec l'armée ennemie.
Mais, tirant parti de l'espace russe, les Russes se dérobent aux attaques et insidieusement, d'étape en étape, entraînent la Grande Armée vers l'Est...
Pitoyable retraite.
La Grande Armée était entrée en Russie le 24 juin avec près de 700.000 soldats dont 300.000 Français.
Après une campagne difficile, elle était arrivée à Moscou pour en être chassée presque aussitôt par l'incendie de la ville.
Napoléon I° avait choisi de battre en retraite par le même chemin qu'à l'aller, harcelé par les troupes ennemies... et les premiers froids de l'hiver.
Le maréchal Michel Ney commande l'arrière-garde et couvre de son mieux la pitoyable retraite.
Malgré cela, en arrivant au bord de la Bérézina, l'empereur ne dispose plus que de 49.000 combattants, non compris 40.000 retardataires.

Le 22 novembre, Napoléon apprend que les troupes qui gardaient la ville de Borissov, sur la Bérézina, ont été chassées par les Russes.
La Grande Armée ne peut plus dès lors emprunter les ponts de Borissov.
Talonnée par les 70.000 hommes de Koutouzov, elle doit néanmoins traverser la rivière au plus vite.
Survient alors l'épisode le plus dramatique de la retraite de Russie.
L'ultime défi.
Tandis que les Cosaques harcèlent les troupes démunies de tout, les pontonniers du général Eblé aménagent un passage sur la rivière gelée.
La plupart y laissent leur vie. Pendant 3 jours, ce qui reste de la Grande Armée, entrée en Russie cinq mois plus tôt, va franchir les ponts improvisés.
La glace qui recouvre habituellement la rivière en cette saison, a fondu par l'effet d'un dégel inattendu et les eaux charrient d'énormes blocs de glace.
Le général du génie Jean-Baptiste Eblé a heureusement conservé ses outils malgré les ordres de l'empereur.
En quelques heures, ses 400 pontonniers édifient deux ponts de 90 mètres de long et 5 mètres de large.

En trois jours, les troupes franchissent la rivière pendant que le général Oudinot livre bataille aux Russes afin de faire diversion.
Un pont se brise le 27 novembre, entraînant dans les flots un grand nombre de grognards.
Il est réparé dans la soirée par les pontonniers qui se jettent dans les eaux glacées.
Au matin du 29 novembre, Eblé, qui voit les Russes approcher, met le feu à ses ouvrages.
Des milliers de traînards se noient en tentant d'échapper à l'ennemi.
Parmi eux des femmes et des enfants (cantinières, prostituées, épouses cachées...).
Au sortir de la rivière, Napoléon dispose encore de 25.000 combattants et 30.000 non-combattants.
20.000 retrouveront leurs foyers...
On évalue à 50.000 le nombre de prisonniers et de déserteurs qui feront souche en Russie.
Une grande partie des pontonniers a péri de froid dans l'eau glaciale de la Bérézina.
Six seulement survivront à la retraite et Eblé lui-même mourra d'épuisement à Königsberg.

Sauve qui peut.
La débâcle est totale. L'Empereur rédige un Bulletin dramatique pour en informer l'opinion française.
Ce XXIX° Bulletin de la Grande Armée est un chef-d'œuvre de propagande.
Sans mentir, il présente les événements dans une gradation habile, passant d'une «situation fâcheuse» à une «affreuse calamité» !
Il raconte les malheurs des soldats mais aussi le grand mérite de ceux qui conservent leur gaieté dans les épreuves et se termine par cette phrase, destinée à prévenir ceux qui songeraient à renverser le régime : «La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure».
Napoléon lui-même abandonne ses soldats et rejoint en toute hâte Paris, où un obscur général républicain a tenté de renverser l'Empire.
Il arrive aux Tuileries le 18 décembre, deux jours après son Bulletin et à temps pour en gérer les effets.
Une semaine d'Histoire du 24 Novembre 2025 au 30 Novembre 2025 avec Herodote.net